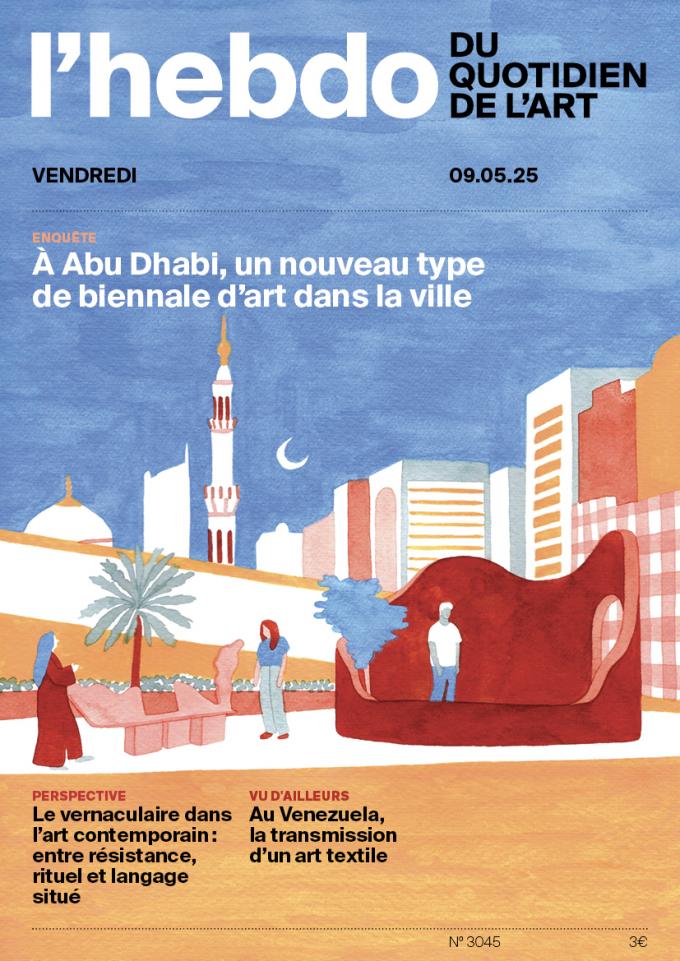« Le vernaculaire n’est pas un retour, c’est un langage que l’on n’a jamais quitté », indique l’historien de l’art et commissaire, Ridha Moumni. Président du département d’art du Moyen-Orient et de l’Afrique chez Christie’s, son territoire de veille lui permet de rester en prise avec les dynamiques artistiques locales, tout en ayant une vision interconnectée des enjeux globaux. « Le vernaculaire n’est pas un concept monolithique », ajoute-t-il. Il est mouvant, fluide. Ainsi, il ne s’agit pas de valoriser des formes locales comme des survivances folkloriques, mais de reconnaître que la modernité elle-même a pu se construire sur une série d’exclusions : celle des corps, des gestes, des savoirs. Le vernaculaire ne vient pas ici « enrichir » l’art contemporain : il en révèle les angles morts, les refoulés et les impensés. Ce n’est pas un retour à une origine, mais un mode d'attention. Aux gestes, aux silences, aux mémoires souterraines. C’est une résistance à l’homogénéité. Enquêter le vernaculaire aujourd’hui, c’est donc refuser les effets de surface : il s’agit d’écouter ce que les gestes savent, ce qu’ils réparent, ce qu’ils opposent.
Le vernaculaire comme énergie
L'artiste béninoise Pélagie Gbaguidi se définit comme une griotte contemporaine, une voix des temps présents réactivant les récits oubliés et invisibilisés. Pour elle, le vernaculaire n'est pas une nostalgie des traditions, mais un processus de résistance et de réinvention, où mémoire collective et gestes du passé se réajustent face aux urgences du monde actuel. « Le vernaculaire se redéfinit sans perdre la trace des liens », affirme-t-elle. Dans l’exposition « Antre » (qui s’est tenue à la Verrière à Bruxelles jusqu’au 29 mars), cette vision prend forme dans une mise en espace décousue où le spectateur devient acteur, fragment d'une œuvre ouverte. En utilisant des matériaux comme des sacs de farine usés, elle symbolise la fragilité des corps et des territoires dévastés par les logiques extractivistes. Ces fragments, recousus et réassemblés, deviennent des supports de mémoire et de résistances invisibles. Avec cette composition, elle invite le visiteur à une réflexion sur la colonialité, tout en échappant aux jugements esthétiques classiques. Ainsi, le vernaculaire, loin d’être figé, devient un outil pour réactiver les liens sociaux et collectifs : en mêlant mémoire et soin, Pélagie Gbaguidi propose une vision de l’art comme agent de transformation sociale, où gestes, corps et formes organiques s’entrelacent pour ouvrir un dialogue essentiel sur la justice sociale. « La forme devient esprit », dit-elle, affirmant que chaque œuvre est une tentative de « retarder la fin du monde » en créant des espaces d’espoir, de résistance et de solidarité.
Le vernaculaire à mains nues
Pour l’artiste M’barek Bouhchichi, la notion de vernaculaire est à la fois précieuse et piégée. Si elle peut réactiver des mémoires, elle peut aussi cristalliser des assignations. « Je suis un artisan mobile », dit-il. Mais pas nomade ! M’barek Bouhchichi reste ancré dans son village au sud de Marrakech. Ancré dans le geste partagé avec ses artisans : « Les gestes que je fais sont des ponts entre des lieux, des hommes et des histoires », précise-t-il. La matière, chez lui, n'est pas ornementale, mais porteuse de récits et de mémoire. Terre, bois, encre : autant d’alphabets sensoriels, résistants à la spectacularisation du monde. Face à l’accélération du marché de l'art, à la circulation instantanée des œuvres et des artistes, lui évite les vernissages et choisit la temporalité du partage, de l'écoute, du compagnonnage. Sans en faire un manifeste, il crée un espace de réactivation des savoirs et de formes de pensées minorées. Avec la commissaire Sonia Recasens, le vernaculaire prend une voie nouvelle : celle d'un geste curatorial humble et situé. Dans « L’esprit du geste » et « Aïta », les expositions qu’elle signe à l'Institut des Cultures d'Islam et au FRAC de Bordeaux, elle met en lumière des formes invisibilisées – gestes domestiques, artisanat féminin, chorégraphies non normées – et déplace ainsi la réflexion vers les mémoires ancrées dans le quotidien. Cette approche déhiérarchise la création, transformant l’opposition entre l’art et l’artisanat en une intelligence du geste et une poétique de la transmission. Pour elle, des artistes comme Selma et Sofiane Ouissi ou M’barek Bouhchichi deviennent les vecteurs de cette réinscription du vernaculaire sans la revendiquer en esthétique. Laaroussa de Selma et Sofiane Ouissi est, en effet, un hommage chorégraphique aux potières de Sejnane en Tunisie. La pièce illustre ce que Sonia Recasens appelle un « alphabet gestuel situé » : une écriture du corps nourrie de gestes vernaculaires, de savoirs artisanaux et de transmissions silencieuses. Selma et Sofiane Ouissi ont observé les artisanes au travail, filmé leurs mouvements, décortiqué les gestes – pétrir, façonner, lisser, polir – pour en faire la matière d’une partition dansée. Ce n’est pas une simple restitution de la tradition, mais une traduction corporelle du vernaculaire. Une manière de faire circuler des cultures par le rituel, de les faire parler à travers le corps. Et ce, non pas en héritage à préserver, mais en mémoire vivante à raviver par le geste.
Révéler les silences
L’artiste textile Fatima Levêque « travaille sur la transmission des savoir-faire informels et la légitimation culturelle des textiles berbères et arabo-musulmans ». À travers son projet au musée d’Angoulême, elle engage un dialogue critique avec les broderies fragmentées de la période coloniale, réactivant une mémoire laissée en marge des archives traditionnelles. Des pièces jugées trop endommagées ou insignifiantes pour être conservées deviennent alors des archives porteuses de récits éclatés. L'objectif n’est pas ici de restaurer, mais de révéler des silences, la mise en lumière de ce qui a été effacé. Dans son travail, l’artiste se penche sur la collection de Prosper Ricard, une figure coloniale clé dans la patrimonialisation des arts dits « indigènes ». Cette collection, composée de fragments de broderies marocaines, l’amène à collaborer directement avec des brodeuses marocaines, afin de redécouvrir les techniques de « tarz » spécifiques à chaque région du pays, dont certaines sont en voie de disparition. Une tentative de reproduction d’un couvre-miroir, utilisé autrefois par la mariée lors de sa nuit nuptiale, échoue : certaines brodeuses ne maîtrisent plus les gestes traditionnels ou ignorent la fonction de l’objet. Cette démarche met en lumière la réalité de la perte et ouvre un dialogue fertile avec les nouvelles pièces brodées par l’artiste. L’enjeu pour l’artiste est de redonner vie à ce patrimoine figé, d’ouvrir un espace où l’histoire discontinue. Et le musée devient un lieu de friction entre mémoire et oubli, entre visibilité et effacement. Ici, le vernaculaire ne se contente pas d’être conservé : il retrouve sa puissance critique.
Relier les vivants
Et si le vernaculaire n’était pas simplement ce qui reste du passé, mais ce qui résiste, dans le présent, à être avalé sans réponse ? C’est cette hypothèse que Livia Melzi explore dans son projet sur les manteaux Tupinambá, ces capes de plumes rouges, jadis utilisées dans des rituels anthropophages par les peuples Tupi, aujourd’hui oubliées dans les réserves des musées européens. Photographe et chercheuse, elle interroge les dispositifs d’exposition de ces objets, adoptant une approche « anarchiviste » : une pratique qui remet en question les hiérarchies de l’archive officielle en réarticulant les archives coloniales avec les mémoires contemporaines. Glicéria Tupinambá, artiste et activiste descendante du peuple Tupinambá, a quant à elle pu reconstituer les manteaux à partir des images de Livia Melzi. Elle transpose ainsi des symboles et réactive des savoir-faire en réinscrivant ces formes dans une histoire vécue. Et la photographe de préciser : « À partir du moment où mes images passent dans la main de Glicéria, elles changent de statut. » Elles s’enracinent dans des récits familiaux, des gestes transmis dans les cosmologies autochtones. Dans le film Quando o Manto fala e o que o Manto diz (Quand la cape parle et ce que dit la cape), fait en collaboration avec le réalisateur Alexandre Mortagua, un manteau de plumes est recréé au sein de sa communauté. Ce n'est pas un geste patrimonial, mais politique, spirituel et collectif. Le manteau parle. Il dit. Il réclame. Pour rendre visible cette réappropriation, Livia Melzi propose en 2022 une série d’autoportraits où Glicéria Tupinambá, pour la première fois, porte ce manteau. Cette dernière détient le déclencheur, choisit le moment où elle crée l’image. Ce geste déplace le regard et fait partager l'autorité de la création. Quant à Livia Melzi, elle crée un espace de passage. Ce transfert d’images devient éthique et situé : il permet aux gestes autochtones de revenir dans le visible selon leurs propres logiques. Ainsi, cette double pratique – critique visuelle et rituel de réparation – donne naissance à une écologie du vernaculaire : ni folklore ni style, mais un mode d’existence pluriel, où la mémoire devient action et où les savoirs minorés renaissent.
Cosmopolitique et survivance
Dans le sillage des philosophes Donna Haraway et Isabelle Stengers, la cosmopolitique se définit comme l'art de composer avec des mondes hétérogènes, où humains et non-humains, savoirs dissonants, se confrontent. Penser cosmopolitiquement, c’est accepter de ne pas tout intégrer dans un système unique, mais d’apprendre à écouter ce qui dérange, ce qui résiste à être intégré. Cette posture de décentrage interroge les récits dominants et les hiérarchies de savoir et de pouvoir qui structurent le monde. C'est dans cette perspective qu'il faudra lire le travail de Gabriela Carneiro da Cunha. Dans Altamira 2042, elle traite de la destruction écologique causée par le barrage de Belo Monte et des luttes des communautés indigènes du Brésil face à l’exploitation de leurs terres. Dans Tapajós, visible en mai à Vidy-Lausanne, elle explore les conséquences de l'exploitation minière sur les rivières amazoniennes, notamment la contamination de l'eau par le mercure et ses effets sur la maternité, dont la contamination du lait maternel. Ces projets s’inscrivent dans une démarche interconnectée avec les communautés locales, où l’art devient une forme de résistance, un moyen de guérison collective et de revitalisation des savoirs ancestraux. Il ne s'agit pas de représenter sur scène les cultures vernaculaires, mais de les faire circuler par le rituel et de les incarner à travers le corps. Le rituel devient un acte politique.
La chercheuse mexicaine Georgina Sánchez Celaya étudie l’écoperformance rituelle. Pour elle, Gabriela Carneiro da Cunha « ne représente pas », mais sert de relais. Dans son travail, « le rituel devient un acte politique, un lieu pour écouter, pour ouvrir un espace où la mémoire et le soin peuvent circuler ». Gabriela Carneiro da Cunha choisit d’agir comme alliée, en mettant en place un « vernaculaire vivant et incarné ». Ses écoperformances ne se contentent pas de documenter la destruction écologique ; elles ouvrent des espaces où les communautés peuvent s'extraire de la mémoire coloniale et reprendre leur place dans le monde en tant qu'acteurs de leur propre histoire, en faisant circuler de nouvelles images.
Vernaculaire et art brut
Peut-on penser ensemble vernaculaire et art brut ? À première vue, tout semble les opposer : le premier renvoie à une mémoire collective, une tradition en tension avec la modernité, tandis que le second s’est construit historiquement comme l’expression d’une subjectivité radicalement singulière, échappant aux normes culturelles, sociales et artistiques. Et pourtant, une hypothèse fragile, mais féconde, émerge : et si ces deux régimes de création partageaient un même pouvoir de trouble ? Dans les deux cas, il ne s’agit pas d’un style, mais d’un écart : à la langue dominante, aux récits établis, aux formes canoniques. Le vernaculaire dérange quand il s’infiltre là où on ne l’attend pas – dans l’art contemporain, dans les musées, dans les performances politiques. Morteza Zahedi, artiste et co-commissaire de l'exposition sur l’art brut iranien, visible actuellement à la Halle Saint Pierre à Paris, fait le parallèle : « Les œuvres issues de l’art brut ne cherchent pas une reconnaissance culturelle ou identitaire, elles surgissent d’une rupture avec toute cohérence instituée. » C’est dans cette même tension que le vernaculaire trouve sa place : loin d’être un retour aux sources, il devient une empreinte fantôme, une mémoire souterraine des gestes quotidiens, des croyances orales, des savoirs non institués. Martine Lusardy, co-commissaire de l'exposition et directrice de la Halle Saint Pierre depuis 30 ans, connaît bien son sujet. Elle résume cette tension en affirmant que « l’art brut ne s’intègre pas, il interroge. Il subvertit les catégories ». Cette capacité à déstabiliser les catégories dominantes est précisément ce que le vernaculaire et l’art brut partagent, et leur fait remettre en question le regard occidental, toujours en quête de normalisation. « Il ne s’agit pas d’assimiler ces formes, mais de les faire dialoguer sans les réduire », rappelle Morteza Zahedi.
Dans ce sens, le vernaculaire n’a pas d’adresse fixe. Il traverse. Il relie. Il engage. Il convoque des alliances entre ceux qui font, ceux qui disent, ceux qui écoutent. Il ne demande ni à être défini, ni à être sauvé. Il continue, dans les plis du contemporain, à ouvrir ce qu’on croyait refermé. Il réapparaît aujourd’hui non pour être célébré, mais pour poser les conditions de son existence. Dans une manière de se tenir dans le monde sans l’arracher à ses formes invisibles.

© Isabelle Arthuis – Fondation d’entreprise Hermès.

© Isabelle Arthuis – Fondation d’entreprise Hermès.

Collection FRAC Champagne-Ardenne © Randa Maroufi.

© Adagp, Paris, 2025.

© Adagp, Paris, 2025. Photo : Marc Domage pour l'ICI – Institut des Cultures d'Islam.

© Adagp, Paris, 2025. Photo : Marc Domage pour l'ICI – Institut des Cultures d'Islam.

© Adagp, Paris, 2025. Photo : Marc Domage pour l'ICI – Institut des Cultures d'Islam.

DR.

© S.Castel, IMA-Tourcoing.

© S.Castel, IMA-Tourcoing.

© S.Castel, IMA-Tourcoing.

© S.Castel, IMA-Tourcoing.



DR.

© Natalie Parrish.

© Isabelle Pateer.

DR.

© La Halle Saint-Pierre, Salim Karami.

© La Halle Saint-Pierre, Abbas Mohammadi Arvajeh.

© Nereu JR.

DR.

© Léo Eloy.