« Le confinement a offert un champ de visibilité favorable à ce que l’on nomme "l’éthique du care". Notamment à travers l’engagement des soignants, l’attention aux fragiles, l’entraide de proximité, et l’envie de maintenir des liens sociaux malgré l’isolement », constate l’artiste-chercheuse Sarah Roshem, diplômée en art thérapie à l’université Paris V, dont les performances participatives sont justement dédiées au care. Apparue en 1982 dans le best-seller de la psychologue américaine Carol Gilligan, Une voix différente, cette notion désigne une attitude éthique centrée sur le soin, la sollicitude et la bienveillance… plutôt que sur l’individualisme et l’indifférence aux autres qui caractérisent bien souvent notre société.
Les vertus curatives de l’art
En réponse aux mesures de distanciation physique dictées par le Covid-19, Sarah Roshem a présenté en juin à la galerie Salon H sa dernière action contextuelle et collaborative, Salmon Ladder. L’enjeu ? Relier 14 participants par un dispositif de sangles et d’élastiques, afin d’établir un dialogue gestuel à plusieurs et composer un « corps commun ». Pour l’artiste, il s’agit de « trouver ensemble un rythme permettant de générer une forme esthétique vivante et joyeuse, jusqu’à nous faire atteindre un sentiment de plénitude ». Sa pratique, qui considère l’art comme « un vecteur d’empathie et d’attention » envers ceux qui nous entourent, agirait donc de manière thérapeutique sur nos passions tristes, à la manière d’un pharmakon.
Issue d’une famille de chercheurs en pharmacie (ça ne s’invente pas !), Jeanne Susplugas souligne quant à elle l’ambivalence de nos traitements en explorant « les phénomènes d’addiction, d’enfermement et de distorsions comportementales ». Sa dernière exposition au musée Fabre de Montpellier, « Pharmacopée » (jusqu'au 10 janvier 2021), s’apparente à une grinçante encyclopédie médicale. Nature morte étale des cachets en céramique sur une table de nuit (les troubles du sommeil ont explosé depuis mars), tandis que Graal condense toute l’ironie de l’artiste dans un comprimé de Lexomil surdimensionné, « un anxiolytique présenté comme le remède à toutes nos névroses », épingle-t-elle. Sa nouvelle œuvre en réalité virtuelle, I will sleep when I’m dead, projetée à l’Ardémone d’Avignon, voyage dans nos neurones. Une odyssée intime qui illustre « les pensées obsessionnelles nées lors du confinement, ainsi que les troubles comportementaux symptomatiques du repli social ». Une manière de nous en libérer, telle une catharsis, et de prendre soin de nous…
Un désir de justice sociale
D’après l’historien de l’art Paul Ardenne, ces propositions révèlent que « le souci du bien acquiert une importance croissante chez les artistes au XXIe siècle ». Il contextualise l’émergence du care : « Les promesses de bien-être annoncées par les politiques providentialistes des Trente Glorieuses n'ont pas été tenues : le lien social s’est distendu, l'altruisme est à réinventer. Or, l'art entend bien participer à ce mouvement de refondation des valeurs humanistes, et mettre en avant un idéal de partage et de protection. » Paul Ardenne rappelle ainsi que le care trouve sa pleine expression dans un désir de « soin concret » et d’« acte de justice sociale ». Pour preuve, la commissaire et critique d’art Isabelle de Maison Rouge a cofondé « Les Amis des Artistes », un « élan de solidarité citoyenne » né sur Instagram pendant le premier confinement, qui permet aux créateurs de vendre leurs œuvres en ligne en percevant 70 % du prix fixé, tout en reversant 30 % à des organismes d’aide aux artistes démunis : « Nous devons être sensibles aux difficultés de ceux qui sont les plus touchés, et souvent écartés des feux de la rampe. C’est le sens de notre action : amener les amateurs d’art à prendre conscience de la précarité du métier d’artiste. Nous cherchons à faire bouger les lignes. » Le succès fut au rendez-vous avec 400 pièces vendues, 180 000 euros de recettes et 54 000 euros distribués aux associations.
Le care apparaît donc comme un levier d’action efficace (quoique parfois modeste) répondant aux enjeux artistiques les plus pressants, dont le féminisme ou l’écologie. D’une part, l’artiste norvégienne Hanne Lippard étudiera lors de sa prochaine exposition au FRAC Lorraine, qu’elle imagine comme « un miroir sociétal », le conditionnement des femmes et de leur voix, historiquement dévolues aux tâches du care. D’autre part, Paul Ardenne présente à la fondation EDF le projet Corail Artefact, mené par Jérémy Gobé. « Avec l’aide de scientifiques, j’ai inventé une résille de textile biodégradable, inspirée d’un motif de dentelle traditionnel du Puy-en-Velay, dont la vocation est de préserver les coraux, menacés de disparaître à l’horizon 2050, et de permettre la réimplantation d’une vie sous-marine », détaille l’artiste, pour qui le care s’étend à un acte de réparation envers l’écosystème, en lien avec une industrie locale en berne. En somme, il espère enclencher un « cercle vertueux écologique et économique » à une époque où les crises, semble-t-il, ne cessent de s’enchaîner.
Jeanne Susplugas - « Pharmacopées », musée Fabre, Montpellier, jusqu’au 10 janvier 2021.
Jeanne Susplugas - « J'ai fait ta maison dans ma boîte crânienne », Ardémone, Avignon, jusqu’en février 2021.
Courants verts, exposition collective à la fondation EDF, Paris, jusqu’au 31 janvier 2021.
Hanne Lippard au FRAC Lorraine, commissariat d’Agnès Violeau, à partir de juin 2021.

© Camille Frasca.

Photo Luc Jennepin-mono/© Jeanne Susplugas/Adagp, Paris, 2020.

Photo Steve Gavard/© Jeanne Susplugas/Adagp, Paris, 2020/Courtesy musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole.

© Clémentine Gras.
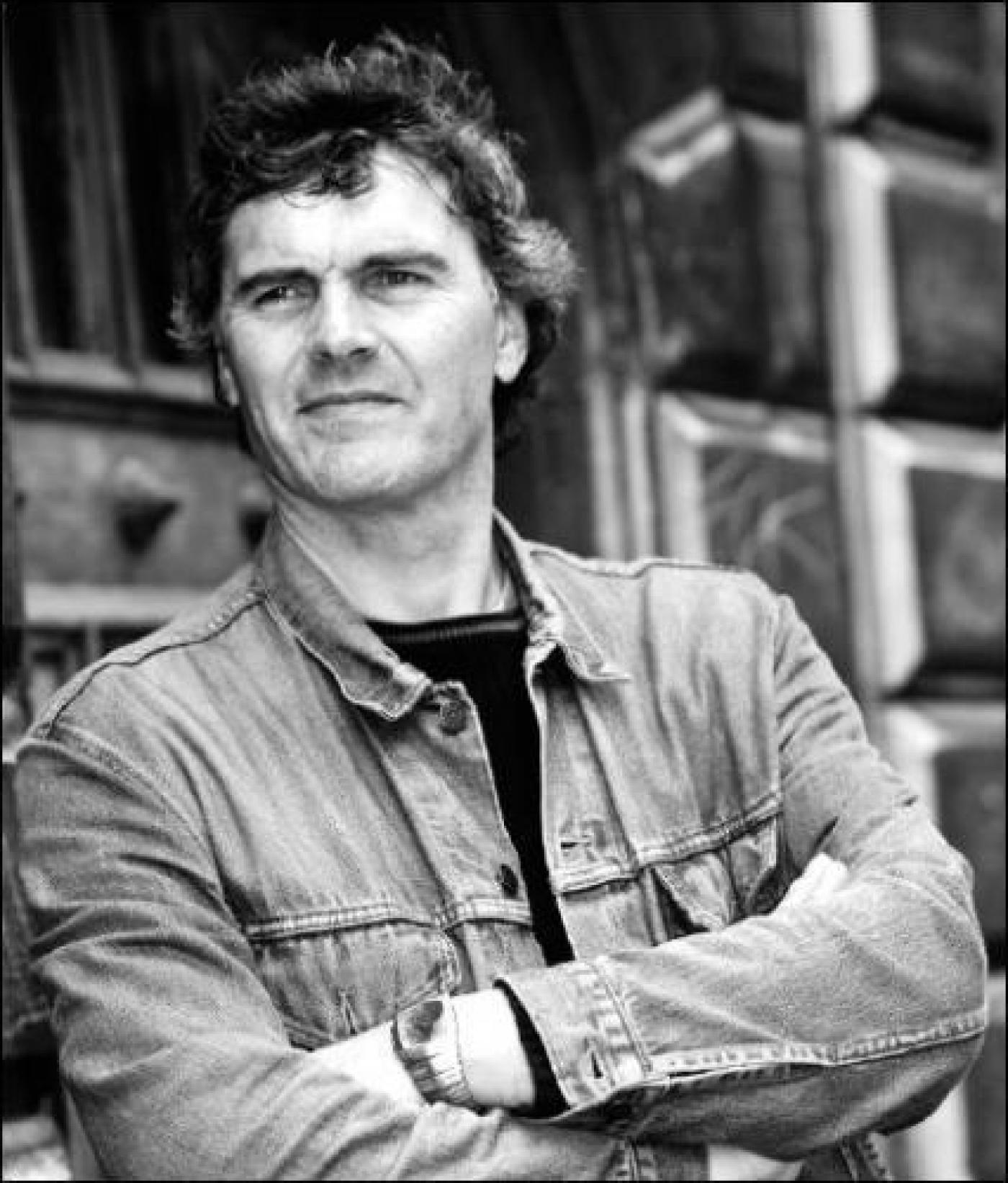
© Sebastien Roy.

© Arash Ghannadzadeh.

Courtesy Sarah Roshem.

Photo Thomas Granovsky/Courtesy Jérémy Gobé.

© Nikolai Saoulski 2020.

© Thierry Boutonnier/Courtesy Maison de la Jeunesse et de la Culture de Laënnec-Mermoz et les habitants du quartier de Mermoz.






