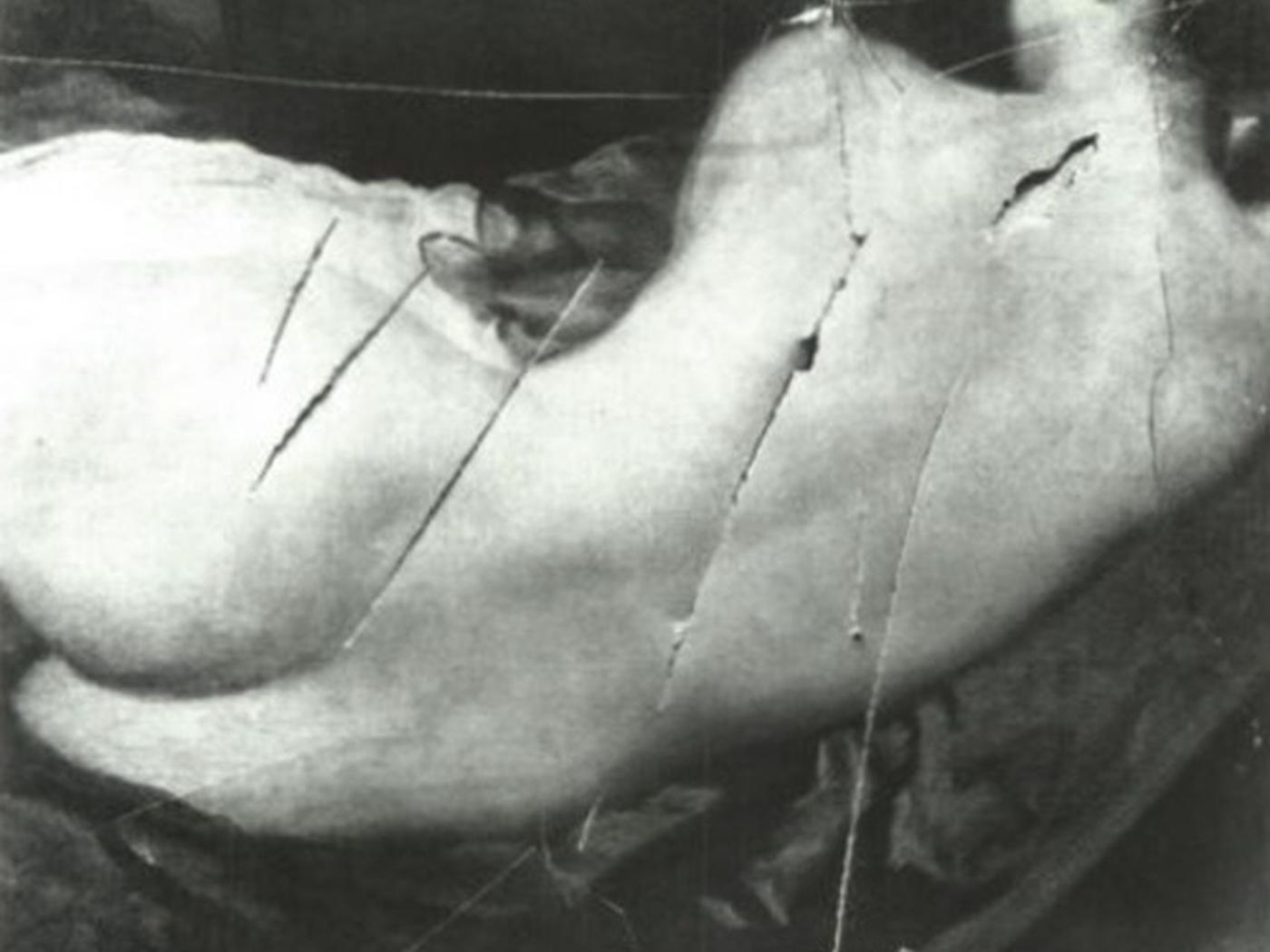« Aujourd’hui, on ne peut plus entrer dans un musée avec un objet tranchant, explique Carole Husson, chargée de conservation et de restauration de peintures, spécialisée en art moderne et contemporain. La présence de détecteurs de métaux à l’entrée des musées a notablement réduit les actes de vandalisme ». Pourtant, en 2013 au Louvre-Lens, lorsque Ingrid Kapola, jeune femme alors sans emploi, abîme La Liberté guidant le peuple de Delacroix, elle n’a pas eu besoin d’une arme : un feutre noir lui a suffi pour y inscrire la mention « AE911 » (référence à l’association « Architects and Engineers for 9/11 truth », qui milite pour l’ouverture d’une enquête indépendante au sujet des attentats du 11 septembre 2001). En 1914, la suffragette Mary Richardson assénait des coups de hachoir sur la Vénus à son miroir de Diego Vélasquez pour revendiquer le droit de vote des femmes et plus de justice sociale. Mais les œuvres attaquées au couteau font désormais exception. Aujourd'hui, les vandales se retrouvent poussés à « réagir avec ce qu’ils ont dans les poches », poursuit Carole Husson. Trousseau de clés, stylos, lime à ongles… La liste est longue. Quelles décisions spécifiques, s’il y en a, prennent les musées pour prévenir ce type de dégradations sur les œuvres qu’ils ont pour mission de conserver ?
Le micro-vandalisme, peu médiatisé
Dans la thèse qu’elle a soutenue en novembre 2018, la jeune docteure en sociologie Anne Bessette dresse une typologie des vandalismes dans les musées français depuis les années 1970 : artistique, psycho-pathologique, revendication sociale et politique ou encore réaction au contenu d’une œuvre... Les plus fréquents – et également les moins médiatisés – sont les actes de micro-vandalisme : « Pour ceux-ci, il est rare que les services de sécurité prennent les gens sur le fait », explique la chercheuse. D’expérience, c’est également à ces actes de micro-vandalisme que Carole Husson a eu le plus affaire. « La plupart du temps, ce sont des réactions à vif, pas forcément délibérées, affirme la restauratrice. Les gens n’ont pas toujours conscience de la gravité de leur geste : ils ne savent pas qu’un crachat sur une œuvre aura des conséquences plus ou moins graves en fonction de la nature de la couche picturale ». Les traces de rouge à lèvres sur les statues grecques, les empreintes digitales ou des enlèvements de matière sur certains tableaux sont les plus fréquents. Dans de tels cas, il est difficile de mettre en place des systèmes de prévention systématique, tant les dégradations sont aléatoires et peu prévisibles.
Récidiviste, l’homme qui avait jeté de l’acide sur la Ronde de nuit de Rembrandt en 1990 au Rijksmuseum d'Amsterdam est allé neuf ans plus tard au Stedelijk Museum pour découper un large trou dans la Femme nue devant le jardin de Picasso. Il s'est ensuite rendu au journal De Telegraaf pour revendiquer son geste. Il aurait déclaré à la police : « J’ai lacéré le tableau, c’était un jeu d’enfant en l’absence de toute forme de surveillance ». Une gardienne d'un grand musée parisien nous explique ne pas avoir reçu de formation spécifique à la protection des œuvres : « Nous faisons simplement un tour des espaces d’exposition, on nous parle des différents risques, mais on nous prévient qu’en cas de dégradation, nous ne pouvons toucher ni l’œuvre ni la personne. On ne peut que tenter de dissuader le potentiel vandale de réaliser son action. »
Carole Husson observe cependant qu’elle voit de plus en plus d’œuvres encadrées ou mises sous verre : « Beaucoup sont protégées par la face, d’autres le sont par des barrières énormes ou une mise à distance, que ce soit une bande blanche tracée au sol ou des câbles ». Tous ces éléments – incluant détecteurs de mouvements et petits trottoirs – réduisent l’accès des visiteurs à l’œuvre. Ironie du sort, parfois ce sont ces mêmes éléments de prévention qui créent l’accident et la potentielle dégradation. Carole Husson explique intervenir en amont des expositions, « quand une toile est accrochée dans un lieu à risque, qu’il soit trop étroit ou lieu de passage ». Une toile abîmée par un sac à dos par manque de place est vite arrivé – bien que le port de sac à dos soit aujourd’hui interdit dans la plupart des musées. De son côté, Anne Bessette développe dans sa thèse que « lorsque l’on découvre a posteriori le vandalisme, l’absence de responsable mène la plupart du temps à un passage sous silence des faits. »
Entre silences et communication contrainte
Que risquent les musées si ces actes de vandalisme s’ébruitent trop ? Anne Bessette évoque les différentes raisons de l’absence de communication des musées à ce sujet. Elle rappelle que dans son livre La Destruction de l’art, Dario Gamboni fait « l’hypothèse que certains responsables de musées ont tendance à "nier l’existence de réactions qui, si on les considère signifiantes, doivent impliquer une sorte de critique du musée ainsi que de l’art et de la culture qu’il représente", tandis que M.J. Williams et Ben Lerner [une juriste et un auteur américains ayant travaillé sur le vandalisme dans les musées, ndlr] soulignent l’intérêt qu’ont ces institutions à minimiser, notamment vis-à-vis des prêteurs et des assureurs, leur vulnérabilité aux attaques ».
Une volonté de passer ces actes sous silence que Le Quotidien de l’Art a expérimentée lorsque nous avons tenté d’entrer en contact avec différents musées à ce sujet : tous ont décliné la demande d’entretien, arguant que les informations demandées touchant à la sécurité du musée et de ses œuvres, ils n’étaient pas en mesure de répondre. Dans sa thèse, Anne Bessette a quant à elle réussi à interroger plusieurs conservateurs, dont un avoue penser que la majorité des actes de vandalisme dans les musées est passée sous silence, sauf dans le cas d’actes « spectaculaires » comme ceux perpétrés sur La Liberté guidant le peuple, le Piss Christ d’Andres Serrano ou encore Fontaine de Marcel Duchamp, dans laquelle l’artiste Pierre Pinoncelli avait uriné. Un autre conservateur d'un grand musée parisien lui expliquait que si un musée subit un acte de vandalisme, « on n’a pas à le déclarer – la Ville de Paris est son propre assureur –, on a juste à restaurer l’œuvre. Soit c’est un acte de vandalisme qui vraiment abîme l’œuvre et, si on a vu qui l’a fait, on portera plainte ; si cela été fait sans qu’on trouve la trace du vandale ou si c’est une dégradation mineure non intentionnelle, on ne va pas porter plainte ».
Difficile donc de trouver des chiffres sur les dégradations des œuvres d’art dans les musées, qui risquent, notamment, de perdre la confiance des autres établissements à assumer leur mission de conservation et d’avoir plus de difficultés à obtenir des prêts pour des expositions temporaires. Dans son ouvrage, Dario Gamboni explique que « l’iconoclasme révèle brutalement la contradiction entre conservation et médiation qui est inhérente aux fonctions du musée : son impact négatif sur l’image de l’institution, sur la carrière des conservateurs et sur leurs futures activités d’acquisition et d’exposition ». Finalement, le vandalisme pose, en creux, la question des missions des musées. Anne Bessette nous confie : « Il faudrait que les musées trouvent le juste milieu, qu’ils acceptent que les dégradations d’œuvres d’art, qu’elles soient volontaires ou non, font partie du jeu ». Et de conclure : « Il faudrait qu’il y ait une sorte de résignation de la part des musées. Il est normal qu’ils ne puissent pas tout prévoir ». Accepter et communiquer, plutôt que de guérir discrètement les plaies d’une œuvre, permettraient peut-être de mieux prévenir les actes de vandalisme par la suite.

© Philippe Huguen/AFP.

© Mamac/Anne Decreux.
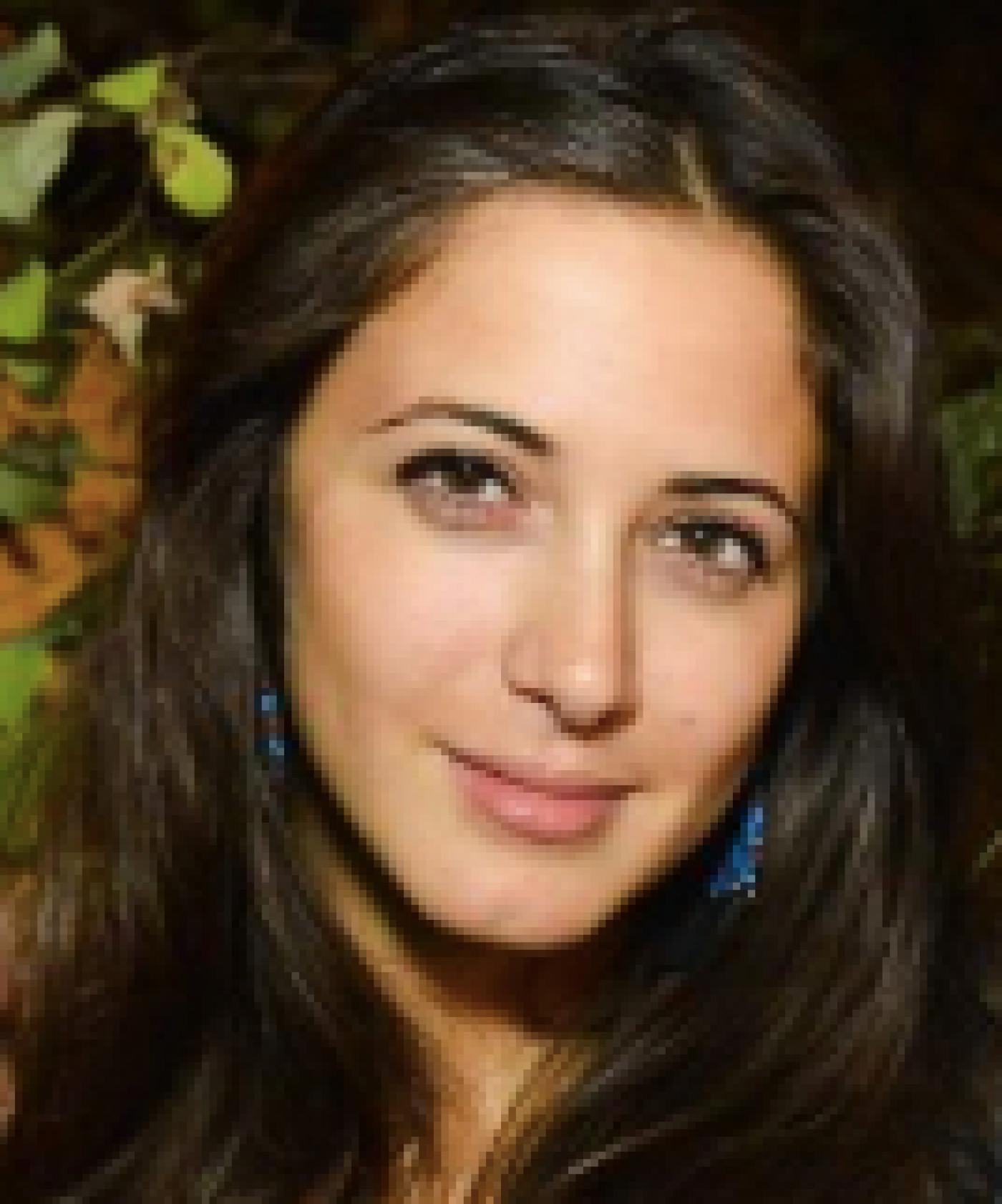
D.R.

© Zeppelin/SIPA.

© Mamac/Anne Decreux.

Coll. M.A.M.A.C. de Nice.
D.R.

© Linkedin.