Il y a des bouts de bois qui flottent, des taches, un battement de cœur interstellaire et quelques notes, dirait-on, de thérémine – cet instrument de musique magnétique qu’on ne touche jamais et qui oblige à ne pas bouger le corps, seulement les bras et les mains. Peu importe que la mélodie soit probablement produite par un synthétiseur plutôt que par la vénérable lyre électronique. Un ou une enfant dit « Dans mon coin je vais l’avoir [inaudible] » cependant qu’une main scratche une attelle sur une petite jambe. Ensuite, il y a la Lune (ou la Terre ?) de loin, qui tourne dans un puits noir. On entend des conversations astronautiques. Un garçon dans une chaise ultraéquipée décolle sur fond de papier aluminium. 4, 3, 2, 1, Houston, je ne vous entends plus. Ses sourcils sont soigneusement dessinés. S’ensuivent des modélisations 3D un peu déchirées d’humains avec exosquelettes, souvent par deux, soignant-soigné ou couples sous le joug de dispositifs médicaux.
C’est le début d’On a roulé sur la Lune (2020) de Camille Gallard, filmé en noir et blanc dans des établissements pour enfants atteints de « déficience » intellectuelle, associée ou non à des troubles moteurs. Aucun misérabilisme ici, aucun malheur non plus. À peine un ado, à un moment, se compare-t-il à une « vraie personne ». Pour le reste, c’est un film exploratoire, littéralement lunaire, un monde plein où le manque se fait puissance. On y suit les amours de Cassandre et Mattéo, deux petiots amateurs de saynètes, et de Dylan et Andréa, préadolescents lourdement appareillés qui nous ressemblent terriblement : aux serments exaltés de Dylan, Andréa répond telle une vieille amante qui ne s’en laisse pas compter : « C’est bon ? C’est bon ? » Sous-entendu : « Tu as…


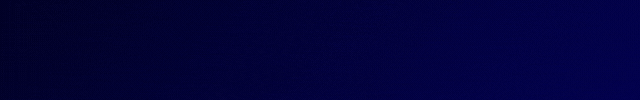



![Ludovic Landolt… sont d’avant l’homme[1]](https://master-7rqtwti-jlxqo7a7rvu5g.eu-2.platformsh.site/media/cache/article_card_thumb/shared/article-image/47252.jpg)
