« I fucking hate Picasso ! », rugit Hannah Gadsby au beau milieu de son spectacle Nanette, diffusé en 2018 sur Netflix et vu depuis par des millions de spectateurs. La comédienne australienne s'explique : « Il a couché avec une mineure, c'est suffisant pour moi, il ne m'intéresse pas », citant la relation entamée à 45 ans par l'artiste avec Marie-Thérèse Walter, alors âgée de 17 ans. Hannah Gadsby ironise : « Mais il a inventé le cubisme ! » La réflexion de celle qui a suivi des études d'histoire de l'art à l'université de Canberra ne s'arrête pas là : « Il a apporté une nouvelle perspective en peinture. Mais l'une de ces perspectives était-elle celle d'une femme ? » Et de conclure : « Et il faudrait séparer l'homme de l'artiste ? »
De fait, pour Picasso peut-être plus que pour aucun autre, l'histoire de l'art a toujours inextricablement lié l'œuvre et la vie personnelle. Des périodes bleues et roses, on passe à une périodisation délimitée par ses compagnes successives, d'Olga Khokhlova à Jacqueline Roque, en passant par Marie-Thérèse Walter, Dora Maar et Françoise Gilot. En 1981, l'historienne de l'art Rosalind Krauss le faisait brillamment remarquer dans son texte « In The Name of Picasso », critiquant la méthode de ses confrères qui faisaient « une histoire de l'art par le nom propre ». Aborder l'œuvre de Picasso sous l'angle du biographique n'est donc pas nouveau. C'est même la règle, mise en place par l'artiste lui-même. Or une part de cette biographie est longtemps restée dans l'ombre. Depuis quelques années, dans le sillage du mouvement #MeToo, les gender studies appliquées à l'histoire de l'art passent son œuvre au crible des violences, documentées, que Picasso a exercées sur les femmes. Déjà en 1989, la journaliste Arianna Huffington cassait le mythe en publiant Picasso, créateur et destructeur. Plus récemment, en 2020, une autre journaliste, Sophie Chauveau, a publié Picasso, le Minotaure. Julie Beauzac, autrice du podcast Vénus s'épilait-elle la chatte ?, s'est basée sur ces deux ouvrages, ainsi que sur des témoignages de compagnes et proches de Picasso, pour écrire en 2021 l'épisode « Picasso, séparer l'homme de l'artiste », qui a connu un succès phénoménal : multiprimé, il a été écouté plus de 400 000 fois. En préambule elle résume son propos : « Le cas de Picasso permet de s'interroger sur l'esthétisation des violences sexistes et sexuelles, la façon dont l'histoire de l'art s'organise en boys club, comment la société fabrique les génies, et l'impunité qu'on accorde aux hommes puissants ». Si la préparation du podcast lui a demandé des mois d'un travail éprouvant psychologiquement, Julie Beauzac a reçu des retours très positifs. « Non seulement de la part d'universitaires, mais aussi de personnes travaillant dans les musées français, raconte-t-elle. Beaucoup m'ont dit que cela les avait amenés à réfléchir à leur pratique. » Elle ajoute : « Ce que je dis n'est pas nouveau, les chercheuses et chercheurs savent cela, c'est étayé par tout un appareil scientifique. Mais mises bout à bout, ces informations forment un propos à la fois nouveau et complexe ». La réaction du musée national Picasso-Paris a été moins positive. Alors qu'elle avait contacté Julie Beauzac avant la diffusion de l'épisode pour réaliser un cycle de conférences, l'institution n'a ensuite plus donné de nouvelles. Interrogée par l'AFP au sujet du podcast, sa présidente Cécile Debray a balayé alors ce qu'elle considérait comme une « attaque, d’autant plus violente que Picasso est la figure la plus célèbre et la plus populaire de l’art moderne. Une idole qu’il faut abattre ».
Les musées d'art moderne tardent en effet à prendre le pas de la relecture, engagée d'abord par les historiennes de l'art féministes et les études de genre. Avec des milliers d'œuvres disséminées dans le monde entier, Picasso structure de nombreuses collections privées et publiques. En France, les musées qui lui sont consacrés, à Paris, Antibes et Vallauris, défendent ardemment son héritage complexe. À sa mort en 1973, la dation massive de 3500 œuvres à l'État, qui a permis l'ouverture du musée national Picasso-Paris en 1985, oriente sa réception même : la France est redevable à l'artiste, et à sa famille, qui exerce notamment un contrôle serré sur la diffusion de ses images.
La prolifération d'œuvres a par ailleurs permis d'organiser des dizaines d'expositions, l'étudiant sous tous les angles, le confrontant à tous les « maîtres », jusqu'aux artistes contemporains, avec « Picasso.mania » en 2015 (lire notre article du 23 mars 2018). Très peu cependant – et plutôt hors de France – se sont attaquées à son rapport violent aux femmes, qui ne se limitait pas au champ symbolique. En 2000, une exposition au Louvre faisait pourtant déjà l'effet d'une petite bombe. Sous-titrée « Stratégies sexuelles dans l'art d'Occident », l'exposition de dessins « Posséder et détruire », orchestrée par Régis Durand, esquissait une réflexion sur ce que le quotidien Libération nommait alors « les mécanismes de l'histoire d'une oppression », de Michel-Ange à Otto Mühl, en passant par… Picasso. « Picasso érotique » en 2001 au Jeu de Paume évoquait quant à elle la « pulsion sexuelle » de l'artiste sans la relier vraiment à une réalité vécue.
Dans un email, Cécile Debray estime « important pour le musée d’adopter une approche historiographique qui permette de trouver la bonne distance par rapport à ces débats (sur le rapport de Picasso aux femmes, ndlr) et de déconstruire le ''mythe Picasso'' », notamment, dit-elle, en faisant « la part entre des faits avérés, rapportés ou fantasmés ». Une déconstruction que la présidente entend mener par un réaccrochage des collections au printemps ou encore l'invitation d'artistes contemporains, comme Farah Atassi actuellement, qui trouve chez Picasso une inspiration formelle. Et d'inciter à la rencontre avec l'œuvre : « Il s’agit de trouver un juste équilibre qui ne penche pas vers l’hagiographie, mais un éclairage compréhensible et pertinent de sa création. Dans le contexte actuel où les attaques contre Picasso sont beaucoup véhiculées par les réseaux sociaux, nombreux sont ceux, plutôt jeunes, qui entendent parler pour la première fois de Picasso à travers uniquement ce prisme, sans aucune connaissance des œuvres, ni bien entendu du musée. De ce point de vue, il m’apparaît important que celui-ci tente de rencontrer ce public en accueillant tous ces débats, pour surtout les mener vers la découverte de son art ».
Conservatrice au musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne et commissaire d'une exposition-dossier sur le thème des bacchanales de Poussin et Picasso au musée des Beaux-Arts de Lyon, Zoé Marty estime, en tant que féministe, qu'il est « nécessaire d'aborder le sujet [des violences sur les femmes] à bras le corps ». Selon elle, « on n'arrêtera pas de faire des expositions Picasso, et c'est en passant par des études précises qu'on peut questionner ce genre de sujet ». « Certaines œuvres parlent d'elles-mêmes… », souligne-t-elle, évoquant notamment la « Suite Vollard ». Cette série de 100 estampes, réalisées entre 1930 et 1937, est présente dans de nombreuses collections, du MoMA à la BnF et au British Museum, qui en a acquis en 2011 une édition intégrale pour un million de livres sterling. En 2018, une exposition itinérante en Australie présentait ces images d'inspiration néoclassique qui décrivent un Minotaure violeur et un Pygmalion obsédé par son modèle, dont les traits sont empruntés à ceux de Marie-Thérèse Walter. L'exposition, qui donna lieu à une rencontre avec des chercheuses, était accompagnée d'un appareil critique et d'un texte, « Picasso and #MeToo », qui aborde sans ambiguïté le rapport de l'œuvre à la réalité : « L'usage habile par Picasso de plusieurs mythes puissants permet de tempérer la réalité de la violence et du viol que l'artiste, sous les traits du Minotaure, commet sur son modèle ».
L'an dernier l'exposition itinérante « Picasso. Figures », conçue par le musée national Picasso-Paris, était adaptée par le musée national des beaux-arts du Québec, qui y proposait un audioguide sur le thème « Peut-on séparer l'homme de l'artiste ? » Pour sa commissaire Maude Lévesque, interrogée par le Journal de Québec, « il fallait regarder de quelle manière son œuvre peut servir notre société aujourd’hui et comment on peut aborder des enjeux importants. Ne pas seulement regarder le génie ».
À la fin de son spectacle, Hannah Gadsby conclut : « Il faut peindre le monde sous toutes les perspectives possibles ». Une exposition sur « la misogynie, la masculinité, la créativité et le "génie" autour d’une figure complexe et mythifiée comme Picasso » est en préparation pour l'été prochain au Brooklyn Museum. L'une de ses commissaires est Hannah Gadsby. Y fera-t-on le procès de Pablo Picasso ? Là n'est plus la question. Car il ne s'agit pas tant aujourd'hui de juger l'homme seul à l'aune de ses œuvres, que de comprendre le système qui a permis et permet encore de perpétuer l'aura de l'artiste.

Photo AFP.

Photo Delphine Kermorvant.

Photo Bernard Martinez.
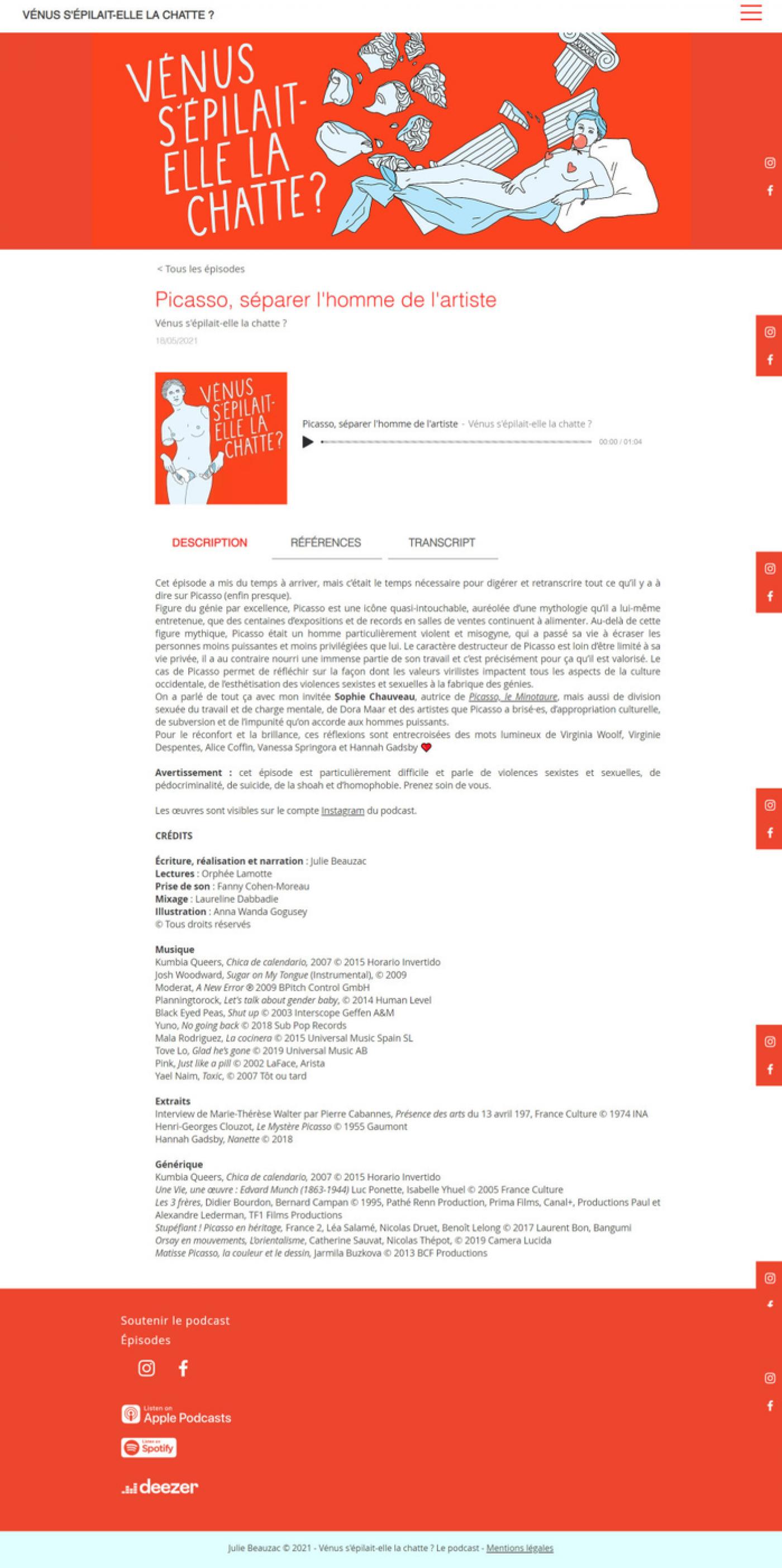
Capture d'écran venuslepodcast.com.

DR.

Courtoisie Almine Rech, Paris, Brussels, London, New York, Shanghai.

© MNBAQ / Photo Idra Labrie.

Courtoisie Farah Atassi.

© Musée national Picasso-Paris, Béatrice Hatala.

© Musée national Picasso-Paris, Voyez-Vous, Chloé Vollmer-Lo.






