Le samedi, à l’heure du marché dans les beaux quartiers de Paris, le restaurant Bambini ne désemplit pas. L’esprit est bon enfant, sur fond de variété italienne. Quelques mètres plus loin, l’humeur n’est pas à la dolce vita. Consacrées pour une bonne part à l’Afrique, les expositions du centre d’art font écho au malaise contemporain. Les cartels invoquent les fantômes du colonialisme et les luttes intersectionnelles, les méfaits du capitalisme et la reconquête du monde de l’art par ceux qui en furent longtemps exclus.
Dans le plus grand centre d’art d’Europe qui fête cette année ses vingt ans, des mondes aux antipodes se croisent, parfois se confondent, dans un détonnant mélange d’insouciance et de gravité. Soucieux de louer ses espaces, le site Internet met d’ailleurs en avant cette diversité de ton et de population, « un modèle original, où l’émergence rencontre la mode, la créativité et les tendances ». Une avantageuse présentation qui fait presque oublier les problèmes.
Car ce site transformiste, dont le curateur Guillaume Désanges vient de prendre la présidence, quatre mois après le départ de sa prédécesseure Emma Lavigne pour la Bourse de commerce de François Pinault, connaît une mauvaise passe. La fréquentation, qui avait atteint un pic de 720 000 visiteurs en 2018, a chuté à 295 000 en 2021. Soit moitié moins qu’en 2019 et un niveau à peine meilleur que 2020. La réduction des privatisations, ainsi que la perte de quelques mécènes, qui assurent 30 % des ressources propres sur un budget de 18 millions d’euros, a sonné le tocsin, en pleine pandémie. Le ministère de la Culture a bien perfusé le Palais de quelque 5,2 millions d’euros sur trois ans. Suffisamment pour redresser la barre, mais pas assez pour retrouver l’énergie des débuts.
Un ballon d'oxygène
Quand le Palais de Tokyo voit le jour en 2002, dans une aile en déshérence d’un bâtiment construit pour l’Exposition universelle de 1937, la scène française est mal en point. Le monde de l’art ne jure alors que par Berlin et Londres. Paris, à côté, paraît provinciale, ratatinée. La génération des Pierre Huyghe et Philippe Parreno a conquis le monde. Mais les plus jeunes rongent leur frein, faute de visibilité. Les institutions parisiennes dédiées à l’art actuel se comptent alors sur les doigts d’une main. La Fondation Louis Vuitton, la collection Pinault et la FAB d’Agnès b. n’existent pas encore, pas plus que les succursales des grosses galeries internationales.
Fondé par les curateurs Nicolas Bourriaud et Jérome Sans, le site de création contemporaine a tout d’un ballon d’oxygène. La jeunesse adopte tout de suite ce laboratoire ouvert de midi à minuit où les artistes bénéficient de folles cartes blanches. Connu pour ses installations coup de poing, l’agitateur suisse Christoph Büchel imagine en 2008 un immense boyau rempli de tonnes de déchets, transformant une partie du centre d’art en squat de junkie ou de SDF. Six ans plus tard, son compatriote Thomas Hirschhorn donne des sueurs froides aux pompiers avec ses braseros fumants, qui, flanqués de pneus et de banderoles, réactivent l’esprit des barricades. En 2018, le Français Neïl Beloufa sème le trouble en renvoyant dos à dos tous les pouvoirs, politique, économique, intellectuel et artistique. À l’automne 2021 enfin, la scénographie ténébreuse d’Anne Imhof et ses performances païennes ravivent les feux du passé.
Un problème de taille
Mais ces coups de maître masquent des difficultés croissantes. En premier lieu financier : il faut trouver 60 % des ressources. Les mécènes répondent présent, mais colonisent aussi la programmation. En 2006, déjà, l’exposition Nivea transformait les artistes en promoteurs de la marque. Des partenaires réguliers comme Audi ou la Fondation Bettencourt orchestrent leurs propres accrochages au sein du Palais. Au risque de la confusion. Sponsor de l’exposition d’Anne Imhof, la marque Burberry monte le son au Yoyo, la boîte de nuit du Palais, au moment même où les performers grisent le public.
Ce système tient-il encore la route ? « C’est un modèle fragile, mais pas essoufflé », assure Laurent Dumas, président du conseil d’administration du Palais de Tokyo. Pour Jean de Loisy, qui a présidé le lieu de 2011 à 2018, l’alchimie glamour-paillette-créativité est toujours opérante. Sa successeure Emma Lavigne a bien tenté de faire évoluer le mécénat en une « co-évolution public-privé », en recrutant des sponsors « qui regardent dans la même direction », vers l’écologie et les sujets de société. Elle a aussi réfléchi à des activités qui pourraient mettre du baume au cœur et du beurre dans les épinards. Aussi a-t-elle lancé avant son départ le HAMO, un centre de mieux-être par l’art, qui ouvrira en décembre prochain, à côté de la librairie.
Mais le problème n’est pas que d’ordre financier. Que faire des 22 000 m2 du Palais de Tokyo ? Dans le milieu de l’art parisien, le sujet est devenu aussi ordinaire que la valeur de Jeff Koons au regard de l’histoire de l’art. Pour Guillaume Désanges, « la taille est une chance, une ressource rare qui permet une permaculture », à savoir l’organisation d’activités multiples et simultanées. Comme un « retour à l’esprit de communautés », que réclame Marc-Olivier Wahler, qui dirigea le site de 2006 à 2011. Nicolas Bourriaud aimerait lui aussi que « la question de l’émergence soit étendue à d’autres disciplines ». Pour le curateur Gaël Charbau, candidat malheureux au Palais de Tokyo en 2019, il faut « retrouver l’esprit forum », tandis que Mark Alizart, qui fut directeur adjoint du site de 2006 à 2011, prône un « retour aux fondamentaux, un lieu d’art et de vie ». L’ouverture que réclame à corps et à cris le petit monde de l’art dépend beaucoup du bâtiment. Qui lui aussi donne des signes de faiblesse. Un audit mené à l’automne dernier par la rue de Valois devrait bientôt chiffrer les travaux. Et déterminer si une fermeture totale ou partielle est nécessaire le temps de la remise aux normes.

© Florent Michel/11h45.

© Florent Michel/11h45.

© François Guillot/AFP.

© Manuel Braun.

© Renaud Monfourny.

© SIPA.
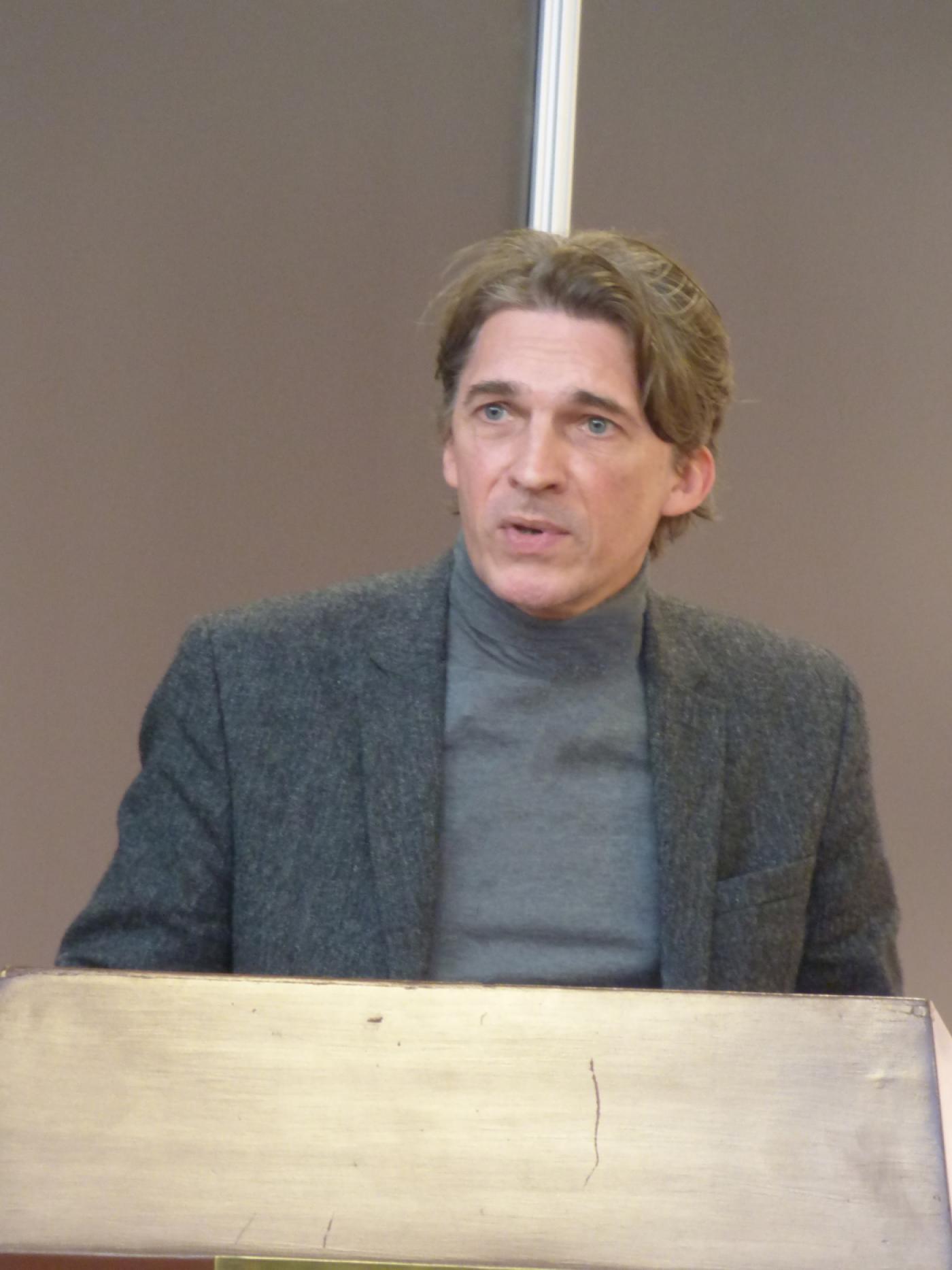
© Luisalvaz.

Photo Andrea Rossetti/Courtesy Anne Imhof, Galerie Buchholz et Sprüth Magers.






