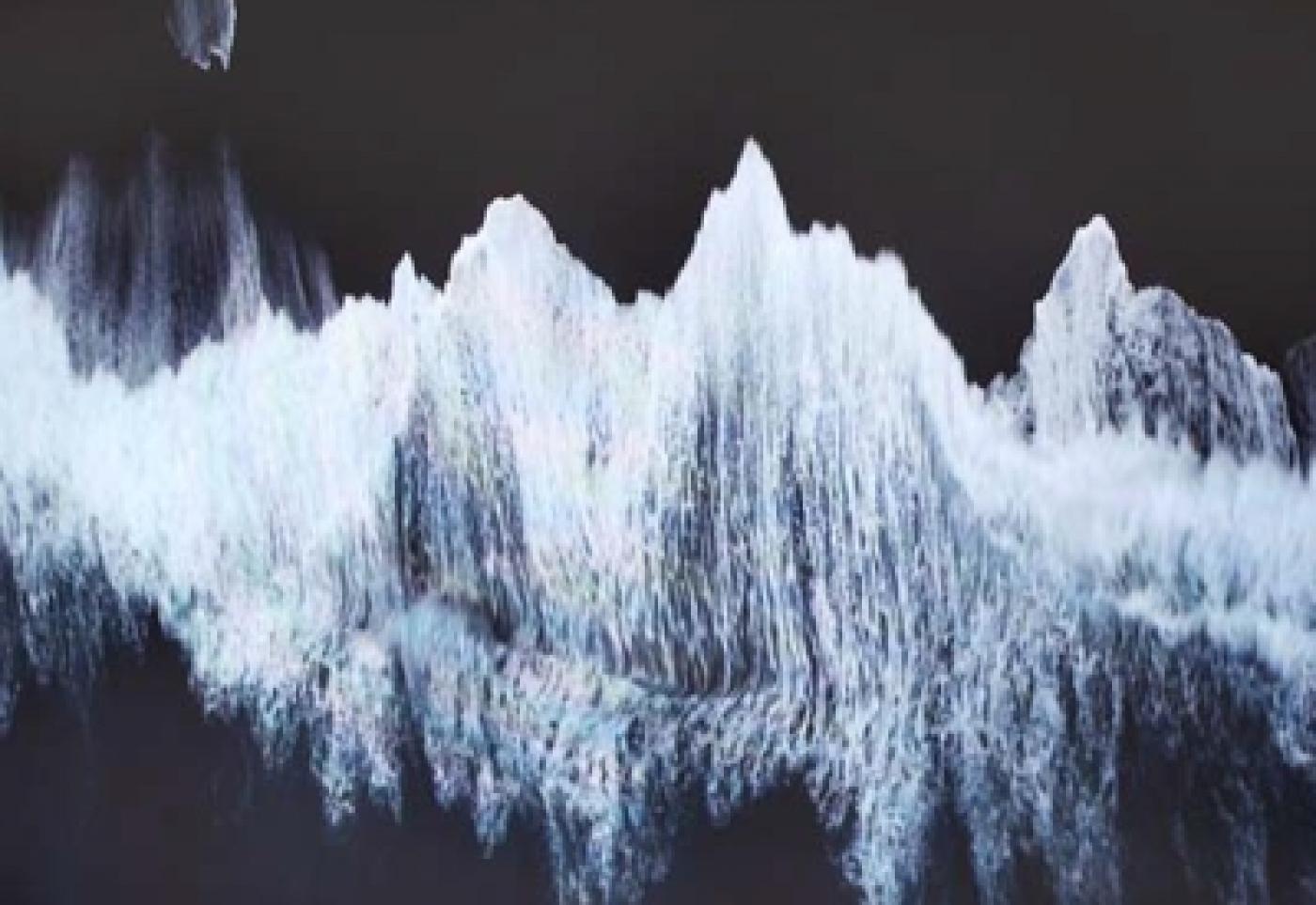Aux artistes contemporains marqués par les soubresauts climatiques, Camille Morineau a choisi d’associer dans l’exposition « Climats artificiels », à l’Espace Fondation EDF à Paris, des générations plus anciennes témoignant déjà dans les années 1960 et 1970 de préoccupations liées à l’impact de l’activité humaine sur l’environnement. Les jardins vénéneux de Tetsumi Kudo témoignent ainsi très tôt de visions inquiètes devant un monde post-nucléaire dans lesquelles les fleurs-pénis de son installation Pollution – Cultivation – Nouvelle écologie de 1971 diffusent leurs arômes fétides. L’œuvre Sky TV que Yoko Ono réalise en 1966 afin de percevoir le ciel depuis son atelier sur un écran de télévision, reflète pour sa part cette distance qui sépare l’individu contemporain des éléments naturels. Mais en 2015, ce dispositif fait pénétrer comme par effraction cette question qui nous taraude sur l’instabilité du climat, nous offrant une caméra de surveillance de ses sautes d’humeur.
Répartie sur l’ensemble des trois niveaux de la fondation, la scénographie découpe le propos en trois parties. Le rez-de-chaussée introduit à la question des « équilibres précaires » du monde. La Mer, une vidéo d’Ange Leccia de 1991-2014, invite à une réflexion sur la question du point de vue. Le ressac projeté horizontalement sur la cimaise s’apparente par son découpage à un profil montagneux inspiré de la peinture chinoise en version 2.0. Les aquariums d’Hicham Berrada, intitulés Présage, présentent des paysages chimiques à la poésie ténébreuse. Les montagnes nuageuses photographiées par Julian Charrière, s’inscrivant dans une tradition du sublime romantique, s’avèrent être des tas de sable recouverts de farine et de nuages en coton : plus que la question de l’équilibre, c’est celle de l’artifice de la nature comme construction intellectuelle qui est soulevée ici.
À l’étage, le point est fait sur « l’état du ciel ». Un état dont l’instabilité et les changements font de toute tentative d’en compiler l’archive une gageure. Spencer Finch essaie pourtant à sa manière d’en restituer les variations chromatiques avec ses ballons dont le bleu varie d’une œuvre à l’autre, évoquant toujours un moment et un lieu précis. Bente Skjøttgaard réalise de son côté d’improbables sculptures en céramiques de nuages, dont la lourdeur contredit la volatilité du modèle (Weather set, 2013). Les aquarelles oniriques de Pavel Pepperstein sont quant à elles annonciatrices de catastrophes énoncées dans leur légende même : « La tache d’huile en forme de swastika dans le monde océan », une allusion directe à la fuite de pétrole dans le Golfe de Mexico, annonçant ici la thématique abordée au sous-sol : les « catastrophes ordinaires ».
Dans sa vidéo intitulée Darzava, Adrien Missika a filmé un cratère créé par accident et duquel s’échappent en permanence des flammes alimentées par le gaz venant du sol. Une vision infernale produit de l’action humaine, à laquelle répond l’étrange vidéo de Laurent Grasso, Soleil Double (2014). Dans le cadre l’EUR, le quartier construit à l’époque fasciste à Rome, une statue rappelant l’esthétique des régimes totalitaires semble saluer deux soleils, comme deux aveuglements concurrents mais complémentaires, deux surenchères éminemment contemporaines : le magnétisme populiste et la frénésie de consommation ? La poésie se trouve ici rabattue dans une question politique à laquelle le climat n’échappe pas.
C’est que la division en trois parties du propos reprend une dialectique présidant à une vision classique de l’ordonnancement du monde : le sol de la réalité au rez-de-chaussée, l’éther du ciel à l’étage et les visions infernales du sous-sol. Celle-ci permet difficilement de saisir les basculements du monde à l’heure où une pensée de l’Anthropocène en dissout les catégories et nous invite à l’envisager comme une globalité interdépendante, dans laquelle tous les champs de la pensée, du savoir, de l’expérience et de l’action sont indéfectiblement liés, et dont l’art se fait l’écho dans des complexités irréductibles aux chapitres d’une exposition.