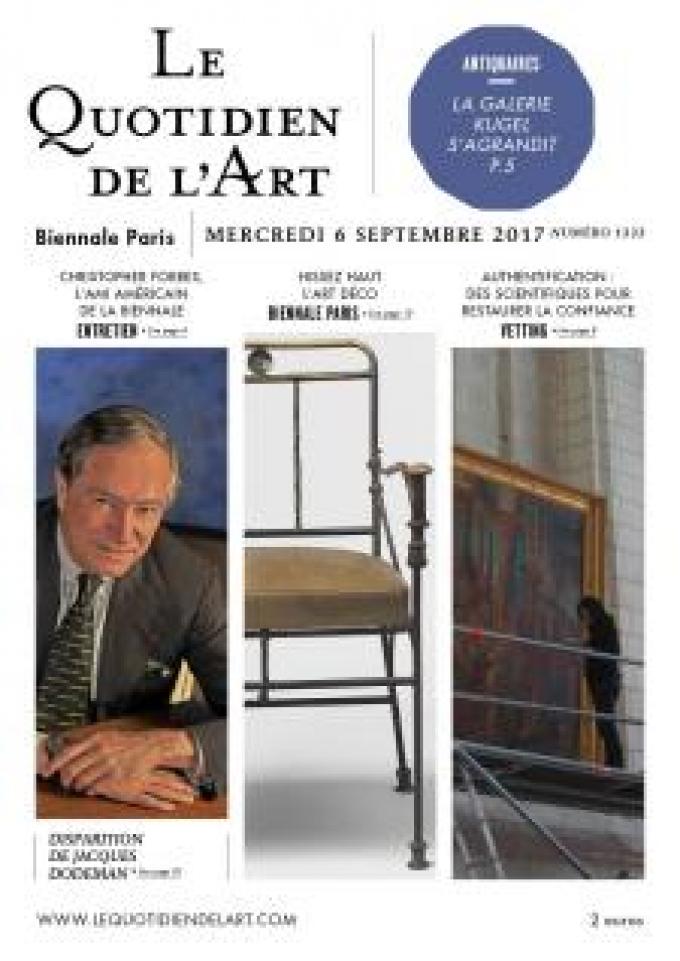Ils ont fait triompher la France lors de l’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes de Paris en 1925 et de la décennie suivante. Aujourd’hui, ces ensembliers-décorateurs font – encore – les beaux jours du marché. Régulièrement, leurs prix s’envolent aux enchères quand sont dispersés les collections d’amateurs éclairés ou de professionnels avisés, du duo Pierre Bergé - Yves Saint Laurent à l’avocat Pierre Hebey, en passant récemment par celle d’Alain Lesieutre. Sous la verrière du Grand Palais à Paris, une poignée de galeries parisiennes est venue défendre la petite dizaine de noms que s’arrache la clientèle internationale la plus huppée. Si quelques enseignes parisiennes et non des moindres manquent à l’appel, ayant tourné le dos à la Biennale Paris, l’offre s’annonce néanmoins solide, les antiquaires apportant des pièces de premier plan. Il ne faudra pas s’étonner de voir souvent les mêmes signatures d’un stand à l’autre. Au risque de se marcher sur les pieds ? Mais le nombre de ces créateurs reste finalement restreint, et « la demande est forte. C’est le signe d’un marché sain quand nous sommes plusieurs sur un créneau », estime Aline Chastel (galerie Chastel-Maréchal, Paris). Bénéficiant d’un stand plus vaste que l’an dernier, celle-ci présente un ensemble de Paul Dupré-Lafon dont un rare bureau gainé de cuir rouge et de parchemin ambré, affiché à plus d’un demi-million d’euros. Dans un esprit éclectique, les héritiers du XVIIIe siècle André Arbus et Gilbert Poillerat conversent avec l’incontournable et prolifique Jean Royère, qui dépasse le strict cadre de l’Art déco avec une armoire aux portes de cuir rouge, mais aussi avec Jean-Michel Frank. Pour la demeure londonienne du mécène des Surréalistes Edward James, ce dernier a créé deux lampadaires « aux proportions plus amples » que son minimalisme coutumier, qualifié de « luxe pauvre ».
Le marchand Michel Giraud (Paris) mise quant à lui sur un grand classique à la palette plus variée, Jacques-Emile Ruhlmann, avec un salon en bois doré « aux dimensions XXL », confie-t-il. Conçu dans les années 1920 pour un château du Nord de la France, il accompagne une importante sculpture en argent du Hongrois Gustave Miklos. La consécration de Diego Giacometti est plus récente que celle de Ruhlmann. À mi-chemin entre classicisme et modernité, Diego Giacometti trône désormais au sommet du marché depuis la vente triomphale en mars dernier chez Christie’s à Paris de la collection du couturier Hubert de Givenchy, où l’une de ses tables avait atteint le prix record de 16 millions d’euros avec les frais (lire Le Quotidien de l’Art des 2 et 8 mars 2017). Michel Giraud exposera une bibliothèque ornée non pas de son habituel bestiaire mais de Victoires de Samothrace. Pas d’animaux non plus sur le stand de Jacques Lacoste (Paris), qui propose une paire de fauteuils de Diego aux accoudoirs terminés en « pommeau de canne » pour laquelle il faut débourser autour de 500 000 euros. Comptez quelques centaines de milliers d’euros pour une table basse Tour Eiffel de Royère en croisillons de métal exposée à côté.
Les amateurs de Ruhlmann s’arrêteront aussi chez Céline et Fabien Mathivet (Paris) pour son salon aux formes octogonales à l’avant-gardisme précoce puisqu’il date de 1916. Les recherches des créateurs Art déco tournaient parfois autour des mêmes idées, comme on peut le voir plus loin chez la galerie Marcilhac, qui présente un fauteuil à pans coupés de Pierre Chareau, de 1920. Sur le même stand figure un lampadaire Feuille d’Alberto Giacometti créé vers 1936 pour Jean-Michel Frank. « Il y a aujourd’hui beaucoup de bons salons dans le monde, observe Aline Chastel. Quitte à être un peu chauvins, il faut défendre Paris en soutenant la spécificité française de la Biennale, cet art de vivre et ce goût exceptionnels ».